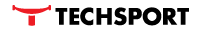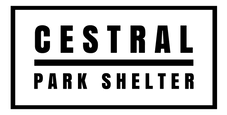Définition
L’architecture de paysage est une discipline de synthèse et intégratrice qui englobe toutes les composantes de l’environnement extérieur aux bâtiments, qu’elles soient rurales, urbaines ou périurbaines.
Sa pratique se définit comme une combinaison des savoirs environnementaux, du design, de l’art et de la science appliquée. C’est par cette mise en commun que sont créés, préservés et mis en valeur des paysages qui constituent une composante première des milieux de vie au Québec.
La discipline est l’interface directe entre les communautés et les systèmes naturels touchés. De par sa nature, l’architecture de paysage participe directement au développement des communautés en rendant le milieu de vie plus humain, vivable et durable.
Les architectes paysagistes reconnus par l’AAPQ offrent l’expertise essentielle à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions pour des environnements construits et naturels.
En se fondant sur des considérations environnementales, physiques, sociales et économiques, les architectes paysagistes produisent des lignes directrices générales, des rapports, des plans directeurs, des plans conceptuels, des documents contractuels pour la construction et la surveillance des travaux qui établissent un équilibre entre les besoins et objectifs des gens et les limites du milieu.
Les décisions et le rendement des architectes paysagistes ont une incidence sur la santé, la sécurité et le bien‐être du client, ainsi que sur le public et l’environnement (voir la matrice de risque des activités dans un chapitre qui suit). Il est donc essentiel que les architectes paysagistes répondent à des normes minimales de compétence.
Dans l’édition 2008 de la Classification internationale type des professions (CITP-08) de l’Organisation internationale du travail (OIT) de l’ONU, la profession d’architecte paysagiste a été classée dans le groupe 216 « Architectes, urbanistes, géomètres et concepteurs », unité 2162 « Architectes paysagistes ».
Elle définit la profession de la façon suivante :
« Landscape Architects conduct research and advice on planning, design and stewardship of the outdoor environment and spaces, both within and beyond the built environment, and its conservation and sustainability of development. For the profession of landscape architect, a degree in landscape architecture is required. » (Bureau international du travail, 2012)
Intervenant à l’extérieur du bâtiment, le Bureau international du travail (BIT) définit la pratique de l’architecte paysagiste dans les champs d’activités suivants :
Champs d’activités
- Planifier, concevoir, gérer, protéger et évaluer la fonctionnalité et l’esthétisme d’implantations d’environnements bâtis en milieu urbain, périurbain ou rural. Ceci inclut tout particulièrement les espaces publics ou privés tels que les parcs, les jardins, les voies cyclables et véhiculaires, les places publiques, les développements résidentiels, les cimetières, les monuments commémoratifs, les ensembles touristiques, les aires commerciales ou industrielles et les complexes éducationnels, les terrains sportifs, les parcs zoologiques, les jardins botaniques, les aires récréatives et les fermes;
- Réaliser ou contribuer à la planification, à la conception des aspects esthétiques et fonctionnels, à la localisation, à la gestion et à l’entretien d’infrastructures telles que routes, digues et divers projets de grande échelle ou de développement énergétique;
- Effectuer des évaluations paysagères incluant des études d’impact environnemental et visuel dans l’optique de développer des politiques ou d’exécuter des projets;
- Analyser des sites à développer en tenant compte de facteurs tels que le climat, le sol, la flore, la faune, les eaux de surface et souterraines, et le drainage;
- Travailler en collaboration avec les clients et parties prenantes pour faire des recommandations se rapportant aux méthodologies et étapes de travail appropriées;
- Identifier et développer les solutions appropriées en rapport avec la nature et l’usage préconisé de l’environnement en milieux urbain, périurbain et rural;
- Concevoir des aménagements, plans et dessins techniques incluant des spécifications, détails techniques, estimations des coûts et calendriers de réalisation;
- Superviser et surveiller la construction de projets afin d’assurer le respect des plans, les spécifications de travail, la prévision de coûts et les échéanciers;
- Coordonner ou superviser le travail d‘autres firmes, professionnels, employés ou ouvriers. Ces tâches et responsabilités peuvent être réalisées individuellement ou en concertation avec tout autre spécialiste ou professionnel dont l’expertise est requise ou complémentaire;
- Diriger des recherches, produire des documents scientifiques et des rapports techniques, enseigner, conseiller sur des éléments tels que les systèmes géoréférencés et de télédétection, les lois et règlements ayant un impact sur la pratique du domaine, les communications et interprétations des paysages et leurs milieux;
- Développer des théories, politiques et méthodologies, nouvelles ou améliorées, concernant la planification globale de paysages, leur conception, la gestion, l’évaluation continue et la pérennité aux échelles locale, régionale, nationale ou multinationale ‐ p. ex. parcs locaux, régionaux et nationaux, aires de conservation et de récréation, sites et jardins culturels ou historiques, etc.
Historique
L’évolution des transformations du paysage, survenues entre les 17e et 20e siècles a façonné l’architecture de paysage au Québec, soit le passage d’un paysage naturel vers un paysage urbanisé. Les premiers colons, les religieux, les ingénieurs militaires, les horticulteurs, les jardiniers et les développeurs urbains ont, à leur façon, pratiqué l’architecture de paysage. Le travail de planification et d’aménagement de chacun a contribué à former le cadre spatial que nous habitons aujourd’hui.
La pratique de l’architecture de paysage débute à l’époque du développement du nouveau continent grâce aux défis qu’ont imposés les grands courants de réforme urbaine, et ce, même si l’appellation d’architecte paysagiste est relativement récente en Amérique du Nord (1857). Les paragraphes qui suivent brossent un tableau de l’évolution de l’architecture de paysage au Québec en présentant quelques grands jalons de la profession.
La tradition européenne
Depuis toujours, l’homme a cherché à aménager son environnement et à intégrer la nature à son quotidien. D’abord, il a désiré contrôler le développement de la nature en l’utilisant à ses propres fins. L’atrium romain, les jardins mauresques, les cours médiévales et les jardins de la Renaissance ne sont que quelques exemples qui reflètent ces préoccupations.
Au 18e siècle, l’avènement des mouvements romantique et naturaliste amènent l’homme à calquer la nature et à composer avec son caractère « sauvage ». On assiste à la naissance des jardins « à l’anglaise » qui détrônent les aménagements dits « classiques » de la Renaissance.
Les premiers jardins
La colonisation du nouveau continent laisse peu de temps et d’énergie pour la création de jardins. Toutefois, à mesure que les villes s’urbanisent et se densifient, on ressent le besoin de se réserver des lieux de détente. C’est ainsi que de petits jardins formels à la française font leur apparition. En Nouvelle-France, au cœur des villes fortifiées de « Kébec » et de « Ville-Marie », ces jardins sont surtout aménagés pour les besoins des administrateurs, des gouverneurs et des intendants.
Des jardins s’intègrent également aux cours intérieures des institutions religieuses en réponse à la recherche d’autosuffisance des communautés. De plan carré et composés d’axes perpendiculaires, ces jardins intègrent des cultures maraîchères, fruitières et médicinales tout en offrant un lieu de méditation et de promenade.
Les premières places publiques
Peu à peu les villes se développent et offrent de plus en plus d’espaces dits « publics » tels les squares, les places publiques et militaires ainsi que les marchés. Il est intéressant de constater que la plupart de ces lieux conservent, encore de nos jours, leur vocation publique.
Le 19e siècle
Au 19e siècle, l’accroissement de la population urbaine et l’attrait de la ville provoquent un éclatement urbain. La ville devient congestionnée. La densité des bâtiments, l’absence de véritables systèmes d’égout et d’aqueduc et des conditions de vie pitoyables (manque de lumière, air vicié, haut niveau de bruit, etc.), rendent la vie difficile. Ces conditions, jumelées à des épidémies de choléra, poussent la classe aisée à quitter la ville. Naissent alors, aux abords du périmètre des villes, de grandes résidences d’été (ou villas) qui deviendront plus tard des résidences permanentes. L’ensemble de ces villas met en évidence la relation architecture – nature à travers de magnifiques jardins dont l’aménagement est axé principalement sur des points de vue géographiques.
La dégradation constante des conditions de vie au cours du 19e siècle entraîne finalement une réforme urbaine préconisant la création d’espaces verts publics au cœur des villes. C’est aussi à cette époque qu’apparaissent les sociétés horticoles, les jardins botaniques et les parcs à vocation naturaliste.
Frederick Law Olmsted (1822-1903)
Premier professionnel à employer le titre d’architecte paysagiste lorsqu’il réalise son plan de Central Park à New York, Frederick Law Olmsted est le mentor des architectes paysagistes d’Amérique du Nord. Ses travaux et sa pensée ont influencé l’action des professionnels dans la conservation et la planification des parcs tout au long du 20e siècle. Pour Central Park, Frederick Law Olmsted introduit un nouveau concept de parc urbain qui, à travers le style de l’école du romantisme anglais, propose à la fois des lieux naturels de détente et des espaces de loisirs actifs.
En 1874, la réputation d’Olmsted est reconnue à travers le continent, et la ville de Montréal lui donne le mandat d’élaborer un plan de parc public sur le mont Royal. Graduellement, le bureau d’Olmsted fait école, ses disciples se multiplient et plusieurs projets d’envergure en architecture de paysage sont réalisés dans les principales villes d’Amérique du Nord.
Frederick G. Todd (1876-1948)
Frederick G. Todd devient le premier architecte paysagiste à s’établir au Canada, plus précisément à Montréal, en 1900. Même s’il a reçu sa formation aux États-Unis, notamment en travaillant pour la firme d’Olmsted, il est considéré comme le premier architecte paysagiste canadien. Parmi ses plus importantes réalisations, soulignons le parc des Champs-de-Bataille à Québec (les Plaines d’Abraham) et l’Île Sainte-Hélène à Montréal. Todd a également conçu de nombreux plans de développement urbain, par exemple, celui de ville Mont-Royal à Montréal et celui des agglomérations de Pointe-Claire et de Arvida.
Grâce à son influence, la profession a débordé du cadre d’aménagement des jardins privés et des parcs pour devenir une profession au service des entreprises privées et publiques, au même titre que l’architecture et l’ingénierie.
Les années de dépression
Au Québec, les années 30 sont riches en réalisation de projets d’envergure, malgré la situation économique sombre. Dès le début de la crise de 1929, les gouvernements fédéral et provinciaux s’entendent pour combattre le chômage en instaurant de vastes programmes de travaux publics. C’est ainsi que de nombreux projets voient le jour. Frederick Todd réalise des travaux importants : l’aménagement des Plaines d’Abraham qui va bon train entre 1927 et 1939; la restauration et l’embellissement de l’Île Sainte-Hélène qui débutent en 1937; et la création du Lac aux Castors au parc du Mont-Royal amorcée en 1939. Au cours des années 30, on assiste aussi à la création et à l’aménagement du Jardin botanique de Montréal par son fondateur, le frère Marie-Victorin et son architecte paysagiste Henry Teuscher.
C’est en 1934 que les architectes paysagistes, de concert avec les urbanistes fondent « la Société canadienne des architectes paysagistes et urbanistes » qui deviendra l’Association des architectes paysagistes du Canada en 1961. Enfin, c’est pendant cette décennie mouvementée que Louis Perron, le premier Québécois francophone à devenir architecte paysagiste, amorce sa carrière en réalisant le splendide Jardin Jeanne-d’Arc à Québec.
Renaissance urbaine
Les années de la crise économique et de la deuxième guerre ont mené à la stagnation et au déclin du développement des centres-villes québécois. Ces derniers ont par contre été graduellement réinventés vers la fin des années 50 et au cours des années 60. C’est à cette époque que des espaces publics et des lieux de rassemblements innovateurs ont vu le jour d’un bout à l’autre du Québec.
Par exemple, la réalisation de la Place Ville-Marie et de la Place Bonaventure (et son fameux jardin-terrasse) à Montréal, la création des places de l’Hôtel de ville et de la Francophonie à Québec et le réaménagement du parc Champlain à Trois-Rivières. Le projet qui a inspiré le Québec à cette renaissance urbaine est sans contredit Expo 67. Le site de cette exposition universelle consistait en l’aménagement d’une île existante ainsi qu’à la fabrication d’une seconde pour l’occasion par remblaiement puisé à même le fleuve Saint-Laurent.
Pendant les années 60, la Révolution tranquille a transformé la vie politique au Québec, ce qui a donné l’élan à plusieurs grands projets touchant des travaux d’architecture de paysage : l’expansion de la Colline Parlementaire à Québec, le nouveau campus de l’Université Laval en banlieue de Québec et un grand réaménagement de l’Université de Montréal. En même temps, la Commission de la Capitale Nationale (CCN) à Hull et à Ottawa créait un réseau d’espaces verts à l’échelle de la région métropolitaine.
La fondation de l’AAPQ
Expo 67, le « projet du siècle », a attiré de nombreux aménagistes des quatre coins du globe tous désireux de contribuer à un projet de grande envergure. Ce rassemblement d’architectes paysagistes a mené directement à la fondation, en date du 2 juillet 1965, de l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ). Les vingt-neuf hommes et femmes fondateurs de l’Association constituaient un groupe diversifié.
On y retrouvait des Québécois formés aux universités américaines dans les années 40 et 50; des gens d’outremer qui, pendant la période d’après-guerre ont émigré au Québec en apportant avec eux de riches traditions de l’Europe, et plusieurs architectes paysagistes expérimentés venant des États-Unis, de l’Ontario et de l’Ouest canadien, typiques du « savoir-faire nord-américain ».
Création de l’École d’architecture de paysage
Dès la fondation de l’AAPQ, cette bande de pionniers qu’étaient les fondateurs de l’Association, s’est donnée comme mission d’établir un programme d’études en architecture de paysage de niveau universitaire au Québec. Expo 67 avait déjà donné une grande visibilité à l’architecture de paysage et en 1968, l’Université de Montréal mit sur pied un programme d’éducation universitaire d’une durée de quatre ans, menant à un diplôme de Baccalauréat en architecture de paysage. Ce programme – le seul en Amérique du Nord à offrir un enseignement de l’architecture de paysage en langue française – a atteint un statut d’autonomie en 1978, sous l’appellation d’ « École d’architecture de paysage ».
Une profession mature (1972-1990)
L’échelle et la quantité de projets exigeant l’embauche de professionnels de l’architecture de paysage n’ont cessé de s’accroître durant ces années. C’est à cette période qu’on assiste à la création de parcs nationaux et provinciaux de conservation et de récréation ainsi qu’à la naissance des Cégeps. Tous ces projets exigeaient des interventions paysagères spécialisées. De plus, la tenue à Montréal de grands événements internationaux comme les Jeux Olympiques de 1976 et les Floralies internationales de 1980 a contribué à l’essor continu de la profession. Au cours de ces années, une multitude de projets de tous genres et de toutes envergures ont favorisé le développement de la pratique : rues piétonnes, places publiques, terrains de jeux, etc.
Dès 1972, les premiers diplômés de l’Université de Montréal se taillaient une place au sein des ministères, des municipalités et des sociétés parapubliques aussi bien que dans des firmes privées établies dans les grands centres. Graduellement, ces diplômés ont joué des rôles de plus en plus importants – et, éventuellement, prépondérants – dans la profession et au sein de l’Association.
Le 17 mars 1990 marquait le 25e anniversaire de l’AAPQ et plus d’une centaine de membres sont venus célébrer l’événement de manière festive. Lors de ce « Conventum », force fut d’admettre qu’au Québec, l’architecture de paysage était devenue une profession mature, bien établie et reconnue de plus en plus par la société québécoise. À ce moment, l’adhésion à l’AAPQ était toujours en pleine expansion.
Nouvelles tendances (1970-2000)
L’éventail de projets et les façons de les aborder passèrent par des transformations profondes. Des changements sociaux et techniques ainsi que des perceptions esthétiques nouvelles ont donné lieu à une série d’approches touchant au design d’aménagements extérieurs.
Ces nouvelles tendances furent marquées d’abord par la redécouverte de l’aménagement floral et de l’horticulture, et inspirées par les Floralies internationales de Montréal (grande exposition florale tenue sur l’île Notre-Dame, parrainée par le Jardin botanique). Suite à la tenue de cet événement, de nouveaux jardins floraux impressionnants ont vu le jour dans les quatre coins du Québec, autant sous forme de jardins de plantes aquatiques, vivaces ou graminées que de mosaïculture. L’art de la mosaïculture a d’ailleurs été mis en vedette dans le cadre d’une exposition d’été tenue trois années de suite au Vieux-Port de Montréal. Les Floralies, quant à elles, ont été présentées une seconde fois au Québec, cette fois lors de l’événement « Québec en fleurs 97 » dans la capitale. Les foules attirées par toutes ces expositions témoignent encore de l’intérêt grandissant du public pour le jardin de fleurs comme élément important dans l’aménagement des parcs et des jardins. Cet enthousiasme pour le floral au niveau populaire s’est aussi manifesté par une expansion remarquable de l’industrie horticole ainsi qu’une prolifération étonnante du nombre de livres et de revues portant sur le jardinage.
Autre aspect inédit : un intérêt nouveau pour l’histoire et les aménagements historiques. Parce que les idées modernistes ont longtemps guidé le travail des professionnels de l’aménagement, il y avait peu ou pas d’intérêt pour les jardins et les bâtiments historiques. Par contre, vers 1980, une nouvelle tendance inspire le travail de plusieurs professionnels. On protège et on remet en forme des espaces dits traditionnels et on y insère de nouveaux projets dans le tissu urbain. Ce contextualisme s’est illustré de plusieurs façons : l’emploi de « références » aux paysages du passé dans des nouveaux projets (par exemple, la reconstruction du Champ-de-Mars à Montréal); une reconnaissance nouvelle pour certaines formes traditionnelles de design civique longtemps dénigrées (notamment le jardin monastique ou le boulevard urbain, réaffirmé par des projets tels que l’Avenue McGill College à Montréal, le boulevard René-Lévesque à Québec et le boulevard de la Confédération qui délimite le territoire du gouvernement fédéral entre Ottawa et Gatineau).
Ce nouveau respect pour les quartiers anciens se manifeste aussi par le recyclage et la conversion des terrains industriels désaffectés en espaces publics. Longtemps occupés à des fins industrielles et pour des installations ferroviaires, les « Vieux-Ports » de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal et de Chicoutimi sont complètement réaménagés à compter de 1970. Dans certains cas, des environnements riverains canalisés par des ouvrages de béton ont été renaturalisés. Prenons par exemple, la promenade le long de la rivière Saint-Charles à Québec où des plantes indigènes ont recolonisé des berges.
Un autre changement social a mené à de nouveaux besoins dans la conception des espaces publics dès le début des années 70, soit la popularité croissante de ce qu’on appelle la « récréation linéaire ». Ces nouvelles activités récréatives informelles (vélo, jogging, ski de fond) se pratiquent en petits groupes ou individuellement, surtout dans des milieux naturels. Il s’agit d’une approche à la récréation qui se veut plus spontanée que les activités traditionnelles hautement organisées en sports d’équipes et exercées dans des milieux physiques artificialisés. Les départements municipaux de parcs et de loisirs ont commencé à créer des pistes pour ces activités, ce qui a mené à de vastes réseaux de sentiers urbains, souvent bien intégrés aux atouts naturels. Pour illustrer cette « récréation linéaire », on peut penser à la piste cyclable aux abords du Canal de Lachine à Montréal, à la piste cyclable et de ski de fond du « P’tit-Train–du-Nord » dans les Laurentides et au réseau de sentiers créé par la CCN pour les citadins d’Ottawa et de Gatineau.
Bon nombre d’anciens parcs qui s’étaient détériorés ont fait peau neuve dans les années 90. Cette réhabilitation des parcs traditionnels a touché les grands parcs métropolitains dont le parc du Mont-Royal, ainsi que d’anciens parcs de tailles moyenne et petite. On pense par exemple à la replantation des cinq rangées d’arbres majestueux au parc des Vétérans sur le bord du lac dans la ville de Lac-Mégantic.
Enfin, la décennie 1990 a été marquée par les réaménagements majeurs des deux plus grandes villes du Québec. À Montréal, les fêtes du 350e anniversaire en 1992 ont donné lieu à un véritable festival de l’architecture de paysage : la création d’un vaste parc public au Vieux-Port, le réaménagement de la rue de la Commune et du Champ-de-Mars, l’élaboration de paysages éducatifs dont le Biodôme ainsi qu’une série d’autres projets de design civique, de parcs, et d’espaces symboliques. La Ville de Québec et son grand collaborateur, la Commission de la Capitale Nationale du Québec (CCNQ), ont collaboré avec d’autres partenaires à la création d’une série de projets innovateurs afin de permettre au secteur Saint-Roch de regagner son rôle traditionnel de quartier vibrant du centre-ville, de créer de nouveaux parcs et places publiques et de réaménager les autoroutes urbaines qui avaient détérioré à la fois l’expérience et le tissu urbains en boulevards civiques.
Naissance d’un mouvement environnemental
Les changements sociaux et les innovations technologiques accélérées du 20e siècle, en combinaison avec une ignorance sociétale des règles de la Nature, ont créé une véritable « crise de l’environnement » vers les années 60, décennie marquée par la pollution de l’air et de l’eau et la destruction des milieux naturels à une vitesse hallucinante. Cette situation a provoqué une prise de conscience qui a profondément influencé le domaine de l’aménagement. S’inspirant de recherches et de préceptes déjà avancés par des écologistes dont Pierre Dansereau, les concepteurs de paysages ont intégré des analyses systématiques des aspects naturels des sites à leurs processus de design et ont insisté pour que la réalisation de grands projets d’infrastructure soit précédée par des études d’impact sur l’environnement.
En 1987, le terme « développement durable » devient l’expression de choix pour décrire ce mouvement grand et diffus, qui s’exprime aujourd’hui par des efforts nombreux et variables : les toits verts sur des bâtiments urbains, la renaturalisation des berges et des sites dégradés, la reconstitution d’écosystèmes naturels ainsi que d’importantes études multidisciplinaires portant sur des environnements fragiles du Grand Nord.
Le nouveau siècle : projets créatifs et ouverture vers l’international
Au Québec, le début du 21e siècle s’est accompagné de plusieurs nouvelles vagues en architecture de paysage. Déjà dans les années 80 et 90, le design du paysage empruntait de nouvelles directions. Le jardin était conçu de plus en plus comme moyen d’expression d’idées intégrant l’humour, l’ironie et bien d’autres formes d’extériorisation. En 2000, les Jardins de Métis ont fondé le Festival international de jardins qui visait à encourager les concepteurs de paysages à explorer de nouveaux thèmes et à « pousser l’enveloppe » du design des jardins en créant des projets expérimentaux et éphémères. Un peu plus tard, d’autres projets de création originale en architecture de paysage voyaient le jour : les jardins éphémères de l’exposition « Flora international » au Vieux-Port de Montréal pendant les étés de 2006 et 2007 ainsi que des réalisations splendides qui ont marqué le 400e anniversaire de la ville de Québec en 2008, dont la Promenade Samuel-De Champlain longeant le Saint-Laurent.
En même temps, l’architecture de paysage québécoise s’est épanouie et s’est internationalisée. De plus en plus, des bureaux privés et publics ont réalisé des projets importants à l’extérieur du Québec. Dans d’autres provinces canadiennes, des architectes paysagistes québécois se sont illustrés grâce entre autres à l’aménagement du parc Point Pleasant à Halifax et du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick à Edmundston ainsi qu’au projet HtO sur le bord du lac Ontario. Au-delà des frontières, les architectes paysagistes québécois ont réalisé des parcs et des projets de design urbain très appréciés, que ce soit en France, au Chili, aux États-Unis ou en Chine.
Sans le moindre doute, la profession d’architecture de paysage s’est taillée une place importante au Québec. Lors des célébrations du 40e anniversaire de l’AAPQ en 2005, on a pu constater que plusieurs vagues de diplômés issus de l’École d’architecture de paysage avaient atteint le statut de professionnel bien établi. Ils – et elles, car l’Association est autant féminine que masculine – se sont distingués non seulement dans la pratique professionnelle mais aussi par leurs activités dans les milieux de l’éducation, de la politique ou en prenant en charge la direction de services gouvernementaux et d’entreprises privées. Ils se démarqueront certainement autant pour faire face à la globalisation, aux changements climatiques et aux autres défis auxquels la profession sera confrontée.
Ron Williams, professeur honoraire, École d’architecture de paysage, Faculté de l’aménagement, Université de Montréal (sections « Renaissance urbaine » à « Le nouveau siècle : projets créatifs et ouverture vers l’international »).