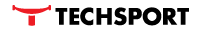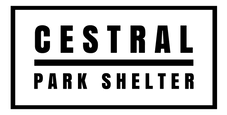Le paysage québécois pourrait-il devenir un bien commun?
- 20 mars 2021
- Paysage , intervention paysagère, analyse visuelle
- Protection et mise en valeur du patrimoine
Source: ici.radio-canada.ca
20 mars 2021 – Par: Benoît Livernoche.
Quand Gérald Domon sillonne les routes du Québec, il note à quel point le paysage a changé à certains endroits depuis les dernières décennies. Ce professeur associé à l’Université de Montréal étudie le lien entre évolution du paysage et perte du territoire agricole.
Nous le suivons sur le chemin des Pères, qui relie Magog à Saint-Benoît-du-Lac. Si, à une époque, on pouvait bien voir le lac Memphrémagog le long de la route, c’est autre chose aujourd’hui. La friche et la forêt ont repris. Il y a des nouveaux arrivants qui ont mis des clôtures et des haies de cèdres. Tout s’est refermé. Ça exprime la perte de certains paysages que l’agriculture a façonnés.
Les Cantons-de-l’Est, comme toutes les régions périphériques, subissent une perte du territoire agricole depuis plusieurs décennies. En 1950, environ le quart de la population québécoise vivait de l’agriculture. Soixante à soixante-dix pour cent des fermes produisaient du lait et les animaux étaient à l’extérieur en pâturage. À cette époque, le territoire agricole occupait une large part des zones habitées et il y avait de nombreux bâtiments dans le paysage.
L’évolution des technologies agricoles, la mondialisation de l’agriculture et l’urbanisation ont depuis modifié notre territoire. Aujourd’hui, avec moins de 1 % de la population qui vit de l’agriculture, le paysage n’est plus le même. Dans les basses-terres du Saint-Laurent, comme en Montérégie, l’agriculture industrielle a agrandi les parcelles, modifié les cultures et largement réduit le nombre de fermes, qui sont devenues beaucoup plus grosses. L’étalement urbain a aussi transformé le paysage et nos villages.
Dans les régions périphériques, la perte du territoire agricole est massive. L’abandon des terres, faute de relève, est frappant à plusieurs endroits.